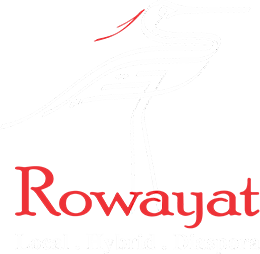Quelles ont été vos sources d’inspiration pour votre premier roman ? Quel a été le déclic pour commencer l’écriture?
J’ai quitté l’Égypte à dix-sept ans après une enfance trop heureuse. J’ai passé un an au Liban, décroché un deuxième bac, français celui-là, puis je me suis installé en France. J’avais besoin de tourner la page. Et puis j’ai été rattrapé par le passé. J’ai toujours voulu écrire mais je n’ai pu publier mon premier roman qu’une fois revenu sur mes pas. Je voulais comprendre l’histoire de ce groupe social au sein duquel j’avais grandi. Pour cela, il a fallu lire beaucoup, interviewer des personnes qui depuis sont décédées, revenir en Egypte sur la pointe des pieds avec beaucoup d’émotion. Et quelque perplexité aussi, car le pays s’était transformé, ne serait-ce que pour une raison démographique. Mais ce qui me touchait surtout, c’était la quasi-disparition du milieu cosmopolite dans lequel j’avais grandi. Le pays avait changé, mon regard aussi. Il s’était occidentalisé.
J’ai écrit Le Tarbouche. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il ne s’agit pas de l’histoire de ma famille, mais d’une famille imaginaire qui aurait pu être ma famille. Ce livre a touché beaucoup de gens, non seulement cette population syro-libanaise dont il est question dans le livre, mais aussi des familles orthodoxes, musulmanes, coptes, juives… Le cosmopolitisme était une réalité. J’ai reçu des témoignages extrêmement variés de cette époque commune. Tout le monde voulait que je fasse une suite. Mais dès le départ, je savais que je n’avais pas envie d’aller au delà de l’exil de mes personnages. Le Tarbouche a eu du succès. Et cela m’incité à continuer. Mais pas exactement comme le souhaitaient certains : j’ai fait en quelque sorte une suite à l’envers.
Vos romans ont en commun d’être très bien documentés. Quelle est votre méthode de travail?
Je suis boulimique de lecture. Pour Le Sémaphore d’Alexandrie, j’ai consulté des journaux de l’époque, pour La Mamelouka, des revues photographiques, des livres techniques. L’idée du Tarbouche m’est venue en tombant sur un document diplomatique. Il s’agissait d’une lettre d’un agent français au Caire pendant la Première Guerre mondiale. Mais je fais attention à ne surtout pas accabler le lecteur de documentation. Et puis je m’inspire aussi d’objets, ou d’images qui me viennent. La Mamelouka est née d’une fascination personnelle pour un vieil appareil photographique. Et je portais le personnage de Mazag depuis vingt ans. Au cours du travail d’écriture, d’autres choses surgissent, qu’on ne peut pas prévoir. Dans certains cas, la fin est connue, dans d’autres, non. L’un de mes grands bonheurs d’écriture réside dans ces « eurêka ».
Dans votre expérience de l’écriture, quelle est, selon vous, la part de plaisir et de souffrance ?
Parfois, on tourne autour de son sujet, on refait dix-sept fois le même chapitre. Dans ces cas là, bien sûr, on peut parler de souffrance. Mais le plaisir se situe à plusieurs niveaux : d’abord, j’écris tous les jours, c’est un plaisir en soi. Ensuite, il y a le temps de la relecture, où on s’occupe d’arracher les mauvaises herbes, de supprimer les formules de jargonnage, les mots inutiles, tout ce qui alourdit ou étouffe. Et enfin, il y a le plaisir de la naissance, quand le livre sort et qu’il devient votre bébé. Même s’il est vilain, pour vous, il reste le plus beau bébé du monde.
Pourquoi le roman ? Et pas le théâtre, la poésie, la nouvelle…
C’est un goût qui me vient de l’enfance. À l’âge de 7-8 ans, je lisais la comtesse de Ségur, Tintin, Jules Verne. C’est le plaisir de raconter une histoire. Même quand j’écris un essai, je suis raconteur d’histoires.
 Quelle différence faites vous entre l’écriture journalistique et l’écriture littéraire ?
Quelle différence faites vous entre l’écriture journalistique et l’écriture littéraire ?
J’ai trois casquettes : journaliste, romancier et auteur d’essais historiques, pour ne pas dire historien. Disons que je vis au milieu des mots, comme d’autres vivent au milieu des chiffres. Mon métier est de raconter des histoires, qu’elles soient aussi exactes que possible ou complètement imaginaires. C’est une alternance nécessaire. L’une me repose de l’autre, mais j’ai besoin des deux. Dans le roman, il y a une charge émotionnelle très forte, une angoisse, celle du tâtonnement. À la fois, cette écriture apporte une satisfaction qu’aucune autre ne donne. Dans un roman, on se met soi-même. D’ailleurs, le rapport que j’entretiens avec les lecteurs de mes romans n’est pas du tout de la même intensité qu’avec les lecteurs de mes essais. Quand je travaille sur un essai, je sais ce que vaut le livre, donc je suis moins sensible aux critiques. Je reçois beaucoup de lettres, et dans les lettres des lecteurs de romans, les gens se livrent. Parfois, des amitiés très fortes sont nées de cette correspondance. Il y a une forme d’appropriation d’un livre par un lecteur qui n’existe que dans le roman.
Quelles sont vos sources d’inspiration, vos pères littéraires ?
Ma source principale d’inspiration, c’est l’enfance. Ce n’est pas un hasard si j’écris sur l’Egypte où finalement je n’ai vécu que dix-sept ans. J’ai découvert après coup que j’avais grandi dans un univers exceptionnel. Le quartier d’Héliopolis était une petite Alexandrie, où les trois religions monothéistes étaient représentées. Il y flottait un air de vacances permanent. Ce sont de ces souvenirs, mais aussi des récits familiaux qui sont parfois des miroirs déformants du réel, que j’ai tiré mon inspiration. Quand j’ai écrit Le Tarbouche, j’avais l’impression d’écrire sous le regard de témoins. Je ne voulais pas tricher. Je ne pouvais pas me le permettre. L’imaginaire que je créais devait correspondre à une réalité. Plus tard, des gens ont soutenu qu’ils avaient connu mon personnage Georges Batrakani ! Qu’il était leur voisin, leur grand-oncle. J’ai besoin de ce souci de vraisemblance. Je ne sais pas faire du fantastique.
Sur quoi travaillez vous en ce moment ?
Je travaille sur un roman dont j’avais écrit les premières pages à l’âge de… dix-neuf ans.