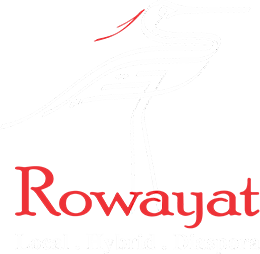Lorsque Albert Cossery publie son tout premier texte dans le numéro de Noël 1937 de La Semaine égyptienne, Le Caire est une ville limpide et blanche. Ses façades mêlent les styles européens en vogue depuis la fin du XIXème : néo-vénitien, art nouveau, art déco, dômes et mosaïques, lignes pures et courbes harmonieuses. Ce centre nouveau voulu par les souverains égyptiens est parcouru de tramways, semé de terrasses de cafés élégants. On y trouve des grands magasins, un opéra déjà ancien, des cinémas, des bars et des clubs à l’anglaise. Cette « ville européenne » dont les Cairotes sont fiers, le jeune Cossery (il a 24 ans) la déteste. « Citadelle de l’ennui bourgeois », elle représente tout ce qui le révolte : le règne d’un luxe tapageur et inutile, l’arrogance de la bêtise satisfaite. « On sentait que la ville voulait vivre, qu’elle avait tout pour cela, mais qu’une sorte de détresse intérieure, impitoyable, la tenait immobile avec ses lumières forcées, ses femmes stupides et son aisance criminelle. Elle avait la parfaite apathie d’un monstre repu ». (Le Coiffeur a tué sa femme, in Les Hommes oubliés de Dieu)
Bien que vivant rue Chérif, ce qui attire Cossery, c’est le quartier fatimide, el Hussein, la ville indigène. Y grouille une foule qui ne connaît ni les ascenseurs ni les cuisinières à gaz, mais donne chaque jour une leçon de vie. Le détachement de celui qui ne possède rien sinon « la simple joie d’être vivant », savourée dans l’instant. Les fils de bonne famille ne se risquent jamais dans cet au-delà du Mouski, à moins d’être doué d’un sens de l’aventure proche du délire. Dans ces ruelles fangeuses, loin de tout pittoresque, caché, raconte-t-il, derrière les moucharabiehs d’une maison proche de la citadelle, l’intrépide Albert s’imprègnera de l’atmosphère et de la verve des personnages qui animeront son oeuvre sa vie durant.
Lui est originaire d’un quartier un peu à part, qui n’a ni la modernité de la rue Fouad, ni les rues décaties d’el Azhar. C’est Faggala, un quartier à dominante chrétienne où s’est installée une forte communauté syro-libanaise à laquelle il appartient. Les monuments en sont des imprimeries, des églises et surtout des écoles fondées par les congrégations françaises, Maristes ou Jésuites. Selim Cossery, le père, descend d’émigrés syriens fuyant les persécutions des années 1860. Si l’on en croit son fils, les occupations de Selim, propriétaire terrien à Damiette, se bornaient à sa longue toilette du matin, la lecture approfondie du journal et des séjours prolongés au café. Le travail ne fait pas partie des valeurs familiales. Selim comprend le français, mais Samira sa femme est strictement arabophone. La langue maternelle des enfants est l’arabe. La mère est analphabète et le petit Albert qui l’accompagne au cinéma lui traduit les cartons rédigés en français expliquant les gesticulations des acteurs encore muets. Pourtant, ces parents si peu européanisés affubleront leurs enfants de prénoms dénués du moindre parfum d’Orient : Edmond, Maurice et Albert. Cela pourrait suffire à prouver l’influence culturelle française jusque dans les foyers les moins ouverts au monde extérieur. D’une certaine façon, le destin littéraire de l’auteur des Fainéants dans la vallée fertile est inscrit dans ce prénom, exemplaire d’une soumission librement consentie à une domination culturelle étrangère.
Le Collège de la Salle, le Lycée français et l’influence de ses frères aînés qui l’initient à Baudelaire, à Balzac feront le reste. Albert est le produit d’une influence linguistique quasi sans partage dans l’Égypte de ce temps. Il serait trop long d’en expliquer toutes les raisons, de Bonaparte aux conseillers français des Khédives. Dans les années 30, quand Cossery décide de se consacrer à l’écriture, le français est partout. Le Conseil des ministres, la Poste, les grands magasins, les sociétés savantes, la presse, les banques ou les restaurants utilisent le français presque exclusivement. L’une des causes majeures de cette prédominance est le cosmopolitisme de la société égyptienne d’alors. Italiens, Grecs, Arméniens, Maltais, Libanais, vivent par centaines de milliers au Caire, à Alexandrie, à Port- Saïd, à Ismaïlia et le français est la lingua franca de ces peuples divers. L’anglais est la langue d’un occupant mal-aimé, retranché dans ses casernes et ses bureaux, et bien peu méditerranéen. Si les Grecs tiennent les commerces et les cafés, les Italiens les ateliers ou les assurances, les Français ont la haute main sur la finance, le Crédit, la Banque et la puissante compagnie du Canal de Suez. En témoigne cette survivance que peu remarquent : les prix des billets de train, des médicaments, des cartes de téléphone ou même des hamburgers du McDonald’s, sont toujours libellés en LE, livres égyptiennes.
Parler de l’activité culturelle en français demanderait une longue étude. Prenons deux exemples seulement, parmi tant d’autres : le ralliement des Irréalistes, groupe d’artistes fondé par Georges Henein, au surréalisme d’André Breton et qu’il a donc quasiment précédé. En 1949, Jean Cocteau effectue une tournée théâtrale en Orient. À Alexandrie (qui compte 150 000 habitants d’origine européenne), la troupe donne matinée et soirée devant des salles combles qui s’enflamment pour La Machine infernale, Britannicus ou Feydeau. Écrire en français est donc pour beaucoup une évidence, Andrée Chédid et Albert Cossery auront les mêmes mots pour répondre à cette question qu’ils ne se sont jamais posée.
« Serait-ce par préférence pour la langue française que vous auriez choisi de ne pas écrire dans votre langue maternelle ?
Je n’ai pas choisi. (…) Si je parlais arabe à la maison avec mes parents, je dévorais aussi les classiques français. Et puis tout cela qu’importe, dans le fond ! Je suis Égyptien et j’écris en français comme beaucoup d’Indiens écrivent en anglais. ” (Entretien avec Albert Cossery. L’oeil de Boeuf, juin 1995) ».
« Je n’ai pas eu à l’adopter (la langue française). Elle fait partie de ma substance ; la parler, l’écrire découlait de source. À travers elle, je n’ai pas eu l’impression de me détourner d’une identité de naissance mais au contraire de la retrouver par un autre chemin de communication ». (Andrée Chédid, La quinzaine littéraire, n°436, mars 1985).
 Cossery est ici exemplaire d’un courant majeur et qui n’a rien que d’ordinaire, dans le microcosme intellectuel des villes, bien sûr. Ces villes sont entourées par l’immense indifférence d’un peuple de paysans analphabètes, occupés à survivre dans le perpétuel recommencement de la misère et de l’oppression. Si « Les affamés ne rêvent que pain », pourquoi écrire dans cet arabe littéraire si compliqué que si peu comprennent ? Le français, au moins, ouvre les portes du monde. Dans ces années, les intellectuels d’Égypte et d’ailleurs croient le monde vacciné contre les nationalismes dévastateurs et rêvent d’universalité. « L’art n’a pas de patrie, pas de terroir », écrit Georges Henein. « Le sol de nos pères, on s’en fout, c’est notre sol à nous qui vaut. Et ce sol, c’est l’univers ». (Rappel à l’ordure, Le Caire, Ed. Masses, 1935)
Cossery est ici exemplaire d’un courant majeur et qui n’a rien que d’ordinaire, dans le microcosme intellectuel des villes, bien sûr. Ces villes sont entourées par l’immense indifférence d’un peuple de paysans analphabètes, occupés à survivre dans le perpétuel recommencement de la misère et de l’oppression. Si « Les affamés ne rêvent que pain », pourquoi écrire dans cet arabe littéraire si compliqué que si peu comprennent ? Le français, au moins, ouvre les portes du monde. Dans ces années, les intellectuels d’Égypte et d’ailleurs croient le monde vacciné contre les nationalismes dévastateurs et rêvent d’universalité. « L’art n’a pas de patrie, pas de terroir », écrit Georges Henein. « Le sol de nos pères, on s’en fout, c’est notre sol à nous qui vaut. Et ce sol, c’est l’univers ». (Rappel à l’ordure, Le Caire, Ed. Masses, 1935)
Par quel autre biais, justement, qu’une langue étrangère, aurait-il été possible dans l’Égypte d’alors, de tenir des propos si violemment à contre-courant ? Par là même, s’explique aussi l’attrait exercé par la langue de Voltaire ou de Rimbaud. Écrire en français délivrait des contraintes, des tabous et des conformismes. Le poète Ahmed Rassim dit avoir adopté le français parce qu’il voulait composer en vers libres, utiliser le poème en prose. Lorsque Al-Tattawor, publication en arabe du groupe Art et liberté, entreprit de traduire les Hommes oubliés de Dieu, la censure en suspendit la publication après la deuxième livraison. Le titre même du recueil dont la transcription en arabe aurait passé pour affreusement blasphématoire, devint Bashar mansiyoun (L’humanité oubliée).
L’inspiration première de Cossery est, justement, alimentée par l’attente des aurores promises, des révolutions salvatrices et vengeresses. Ses nouvelles, tout comme La Maison de la mort certaine, mettent en scène des héros positifs qui s’éveillent à la conscience de classe et à la lutte. Au terme d’une sorte de révélation, Sayed Karam, personnage principal des Affamés ne rêvent que de pain, a trouvé sa voie, la seule possible. « Vivre va signifier : combattre. Combattre dès maintenant et toujours les puissances barbares qui font que les enfants du peuple marchent pieds nus dans le ruisseau, que les hommes de ce peuple mendient dans la rue ou bien acceptent un travail d’esclaves qui ne leur assure même pas le pain de chaque jour ».
Cette littérature édifiante atteint pourtant des sommets grâce à un extraordinaire défilé de personnages hallucinés, à l’humour dévastateur et pour qui l’énigme du monde commence passé le seuil de leur ruelle. La gageure du jeune écrivain cairote : inscrire le rythme, l’inventivité du parler d’un peuple dans une langue autre que la sienne, l’a conduit à un travail de style qui a fait l’écrivain singulier qu’il est devenu.
Quelques lignes de La Maison de la mort certaine valent tous les commentaires :
« Le matin, lorsque les femmes arrivèrent à la maison de Si Khalil, dans le quartier de Manchieh, ce fils de chien n’était pas chez lui. Sa maison, c’était une espèce de petite villa pisseuse, entourée d’une grille dérisoire, qui faisait sourire les voleurs. Ce fut sa femme qui les reçut en criant et leur dit que son homme n’avait rien à faire avec de pareilles dévergondées, et que ce n’était pas une vie d’être dérangé, à chaque instant, par des mendiantes qui n’avaient aucune notion des convenances. Avant son mariage, la femme de Si Khalil n’était qu’une pourriture des rues, mais à présent, elle voulait jouer à la bourgeoise honorée et respectable. Seulement tout le monde savait d’où elle sortait, cette ramasseuse de mégots. Ainsi, feignant de s’intéresser à l’époque de son jeune âge, la perfide Zakiya ne manqua pas de lui rappeler certains détails raffinés, touchant ses exploits d’ancienne putain ». (La Maison de la mort certaine, 1999)
Ce savoureux extrait est représentatif de la confusion volontaire des discours entre l’invisible narrateur et les personnages, réunis dans une langue unique. Le travail de l’écriture n’est pas réductible à une simple traduction. C’est une recréation du dynamisme et de la créativité de l’arabe égyptien dont l’humour sauvage et la propension au paroxysme donnent aux premiers écrits de Cossery leur coloration si particulière. Si j’avais écrit en arabe, j’aurais, comme tous les écrivains de ma génération, fait du Maupassant. C’est paradoxalement en utilisant le français qu’il a su être le seul, peut-être, des écrivains égyptiens à atteindre l’authenticité, la vérité de la langue populaire.
Envions le lecteur qui va lire Cossery pour la première fois, découvrir le monde noir et pourtant irrésistible de drôlerie de Hanafi, le repasseur abruti, de Soliman El Abit, vendeur de melons en chômage hivernal, de Ôm Akouche, « l’odieuse commère, invincible comme un mur » de Si Khalil, « le propriétaire dégoûtant », personnages typiques d’une sorte égyptienne de baroque populaire à l’inventivité verbale sans limites. Les Hommes oubliés de Dieu et La maison de la mort certaine valent même à leur auteur une petite mais flatteuse notoriété qui atteint Paris et New York où Henry Miller salue en lui « l’annonciateur d’une nouvelle aurore, d’une puissante aurore qui vient du Proche, du Moyen et de l’Extrême-Orient (…) », dans la revue Accent, automne 1945, New York.
Cossery, pourtant, n’est déjà plus tellement soucieux de voir se lever l’astre d’une ère nouvelle. Après un repli stratégique et prudent à Assouan au moment de la bataille d’el Alamein, il traverse la guerre et accessoirement l’Atlantique comme stewart sur un paquebot. De retour au Caire, il attend avec une impatience croissante le moment d’accomplir la deuxième partie de ce voeu qu’il se fit à lui-même enfant : être écrivain et vivre à Paris. Enfin, alors qu’il se prélassait sur les bords de la piscine du Mena House, la radio annonça la capitulation de l’Allemagne. Il se précipita en ville réserver une place dans le premier bateau à destination de Marseille.
Ce départ n’a rien d’une fuite, ni d’un exil. En dépit d’une vie intellectuelle d’une qualité rare, le Caire ne pouvait offrir davantage que ce qu’il pouvait, c’est à dire bien trop peu pour un jeune homme exigeant en matière de plaisirs et lassé de la fréquentation des mêmes aux mêmes endroits. « Il suffisait de descendre la rue Kasr El Nil, et on rencontrait tout le monde », me disait-il.
Comme chacun sait, la Fortune, bonne fille, sourit aux audacieux. Le cairote renégat arrive dans une France dévastée mais le Paris de l’après-guerre lui offrira ce qui sera peut-être son dernier âge d’or. Les cafés, les bars, les caves de Saint-Germain des Près où se mêlent artistes, noceurs écrivains, midinettes en quête d’aventures, pourvoiront à l’enfant prodige de Faggala la fête de l’esprit et des sens qui était son idéal d’existence. D’une conversation avec Raymond Queneau, Maurice Merleau-Ponty et surtout Albert Camus, complice aimé des nuits brûlantes, passer aux bras d’une jeune Parisienne peu farouche, danser au rythme de la « trompinette » de Boris Vian, écrire quelques lignes dans cette chambre de l’hôtel Louisiane où il s’installera en 1952, aller du Flore, au Bar Bac, et finir au Montana, à La Rose rouge, : les jours sont trop courts et les aubes trop vite venues pour ce ” dandy égyptien ” déjà légendaire. L’été, une même vie de plaisirs émigre à Saint-Tropez encore méconnu des concierges et des touristes allemands. Comment alors regretter Groppi, les miroirs du Fichaoui et La Revue du Caire ?
C’est pourtant dans ses premières années parisiennes que Cossery publiera les deux chefs d’oeuvre que sont les Fainéants dans la vallée Fertile et Mendiants et Orgueilleux, l’un et l’autre situés dans une réalité égyptienne à des années lumières des Deux Magots. Aussi longtemps qu’il écrira – au rythme très oriental d’un livre tous les dix ans – Cossery retournera vers l’Égypte, inspiratrice, matrice de son inspiration. « Mes personnages doivent vivre au soleil ». Certes, l’idéal d’une vie réduite au strict nécessaire, l’essentiel étant ailleurs, de Gohar ou d’Heykal s’accommoderaient mal de l’hiver parisien. Mais, au-delà des considérations météorologiques, la marginalité des héros cosseriens que nul ne songe vraiment à contrarier, leur sens d’une dérision savante que le peuple comprend et admire, une légèreté dans les relations sociales ou cet usage très particulier de l’emphase et de l’insulte, sont indissociables de son univers d’écrivain.
« Je recommence toujours le même livre », affirmait-il. Ce roman toujours recommencé est inconcevable ailleurs qu’environné de personnages et de l’atmosphère, certes réduits à l’épure, qui ont vu naître sa manière d’écrivain comme sa vison des hommes et du monde. Cette dernière a bien évolué depuis les premiers textes à la gloire des meneurs des révoltes, confuses et bouleversantes, des opprimés des bas-fonds cairotes. Désormais le salut est individuel, à chacun de trouver la marge qui permettra d’être heureux et libre dans un monde livré à la bêtise, à la laideur, au mensonge. L’Histoire, dans son infinie paresse, n’en finira jamais avec les tyrans et « l’imposture universelle ». À l’inverse de bien des intellectuels du Tiers-monde des années soixante et soixante-dix, Cossery s’abstiendra d’exhorter les peuples à l’insurrection, depuis les fauteuils en rotin des terrasses germanopratines. Dans La Violence et la dérision, il fait d’ailleurs de Tarek, partisan de la lutte armée, un égaré, un équivalent tragique de celui qu’il veut abattre.
 La liberté est dans le dénuement, la richesse dans la fraternité de quelques êtres rares, dans cet amour qui entoure et émane d’un maître que rien ne trompe, prince de la dérision, tour à tour acteur et spectateur de la comédie du monde. Le type accompli en est certainement Heykal, héros de La Violence et la dérision et double de l’écrivain lui-même. Il ne s’érige pas en modèle mais son élégance naturelle, son bonheur visible, sa sérénité invincible, attestent de l’exemplarité de ses choix.
La liberté est dans le dénuement, la richesse dans la fraternité de quelques êtres rares, dans cet amour qui entoure et émane d’un maître que rien ne trompe, prince de la dérision, tour à tour acteur et spectateur de la comédie du monde. Le type accompli en est certainement Heykal, héros de La Violence et la dérision et double de l’écrivain lui-même. Il ne s’érige pas en modèle mais son élégance naturelle, son bonheur visible, sa sérénité invincible, attestent de l’exemplarité de ses choix.
Il a compris, preuve de sa haute et précoce sagesse, les vertus cardinales, civilisatrices et subversives de l’oisiveté qui permet, délivrant des masques et des contorsions qu’implique tout rôle social, une relation vraie avec l’autre. Ne rien faire c’est être, pleinement et sans artifice. Tel qu’en lui-même, l’oisif offre à l’autre son vrai visage, son coeur mis à nu. Un amour véritable n’est possible qu’à cette condition. « Tous mes romans sont des histoires d’amour », mais cet amour – sans rapport avec le désir charnel – est l’apanage d’une étroite et joyeuse élite, exclusivement masculine : ceux qui méprisent le pouvoir, l’argent, la respectabilité et la morale commune.
Il en sera ainsi d’Albert Cossery, très rare exemple de vie en accord avec son discours. Il vivra ce que vivent ses personnages, dans la même éthique, celle qui s’affranchit des liens superflus, des possessions absurdes et de leurs soucis inutiles. Jusqu’à sa mort, il occupera une chambre d’hôtel, de plus en plus petite à mesure que les années passent et que les tarifs augmentent, chambre d’étudiant nonagénaire dont le bien personnel le plus précieux était une cafetière électrique. Rendu muet par l’ablation du larynx, « mais cela m’évite de répondre aux imbéciles », rien n’altère son attachement à la vie. Chaque matin fait renaître, sans jamais en être assouvi, « l’extase d’être vivant » qui l’habitera jusqu’à son dernier souffle, jusqu’à ce jour de juin 2008 quand le soleil d’été se lèvera à l’Orient, une dernière fois, au dessus des toits et du clocher de Saint-Germain des Près.